Le feu est un processus biophysique complexe avec de multiples effets directs et indirects sur l'atmosphère, la biosphère et l'hydrosphère. Par ailleurs, il est maintenant largement reconnu que, dans certains environnements propices aux incendies, les troubles du feu sont essentiels pour maintenir l'écosystème dans un état d'équilibre.
Les incendies de végétation sont l'une des
catastrophes naturelles majeures qui endommagent d'immenses surfaces
forestières et herbacées dans le monde entier. Plusieurs centaines de millions
d'hectares de végétation brûlent chaque année dans le monde, avec des
répercussions néfastes sur la situation économique, l'environnement, la
sécurité, la santé humaine, et la faune et la flore sauvages des pays touchés.
La prévention des incendies est l'une des tâches essentielles des politiques
liées aux incendies, et elle exige avant tout une surveillance précise et
effectuée au bon moment. Compte tenu des immenses superficies vulnérables au
feu dans le monde et des observations limitées au niveau du sol, la
surveillance du risque incendie par les satellites opérationnels est une tâche
importante du système mondial d'observation. (Felix Kogan, FAO 1998).
On parle d’incendie de forêt lorsqu’un feu a menacé un massif de plus de 1 hectare de forêts au sens strict (forêts de feuillus, de conifères ou mixtes), ou de formations subforestières (Au niveau de la méditerranée, sont composés par les maquis ; formations fermées et denses sur sol siliceux, garrigues; formations ouvertes sur sol calcaire, et les landes; formations sur sols acides, composées généralement de cistes et de bruyères).
Dans le bassin méditerranéen cette définition varie selon les pays en fonction de celle de la forêt, mais aussi selon des critères annexes : lieu d’éclosion et distance par rapport à la forêt, nature du propriétaire, taille du feu...
Bulgarie :
Tout feu se développant dans les forêts, les plantations, les vergers à graines
et les pâturages.
Chypre : Feu
éclos à l’intérieur des forêts domaniales ou sur des terrains privés à moins d’un
kilomètre des forêts domaniales.
Espagne :
Feu se développant dans des surfaces boisées ou couvertes par des espèces non
cultivées.
France : Feu
qui a atteint des forêts, landes, garrigues ou maquis d'une superficie d'au
moins un hectare d'un seul tenant (et ce quelle que soit la superficie
parcourue). Le terme
"atteint" sous-entend qu'une partie au moins de l'étage arbustif ou
de l'étage arboré a été détruite.
Grèce : Feu
de végétation, en dehors de la végétation agricole.
Italie :
Tous les feux de végétation sont considérés comme des feux de “forêts”.
Liban : Feu
affectant la forêt, les garrigues, les zones de parcours pour les animaux, les
terres agricoles ou les vergers.
Maroc : Feu
concernant les formations forestières et matorrals appartenant au domaine
forestier de l’État ou soumis au régime forestier.
Portugal :
Feu affectant une zone boisée, non agricole ou urbaine.
Tunisie :
Feu affectant des forêts naturelles ou artificielles de plus de 4 ha.
Ces
quelques exemples[1] illustrent bien la grande variabilité dans les définitions des
feux de forêts. Dès lors, les comparaisons entre pays doivent être menées avec
précaution.
 |
| Figure: Part de la surface forestière brûlée dans les pays du bassin méditerranéen entre 1981-1997, FAO, Rome 2001 [1] |
Il est très important de faire distinction entre feux contrôlés et incendie ; les
"feux contrôlés" désignent des feux allumés intentionnellement dans un
but spécifique, tandis que le terme "incendies" correspond à des feux accidentels
ou à des feux ayant échappés au contrôle.
Facteurs et causes des incendies
de forêt:
Il existe 3 facteurs essentiels pour le déclenchement du feu :
-Le combustible (végétation dans
le cas d'un incendie de forêt).
-Une source de chaleur (flamme,
étincelle).
-Le Comburant (Oxygène /vent).
 |
Figure: Facteurs intervenant dans le déclenchement des
incendies de forêt. |
Pendant les périodes de forte chaleur et de sécheresse les végétaux
annuels achèvent leur cycle de vie, certains d'entre eux se dessèchent entièrement
(comme les herbacées), d’autres perdent toutes ou une partie de leurs feuilles,
ces matériaux sont hautement combustible. De plus, certains végétaux (pyrophytes)
comme les Cistes ou le Pin ou encore l’eucalyptus peuvent favoriser les incendies, en effet ils contiennent
dans leurs tissus des substances hautement inflammables, qui, pendant les
périodes de forte chaleur sont dégagées par évapotranspiration.
En contacte de l’aire (qui
contient 21% de dioxygène) le mélange (comburant) devient hautement inflammable,
en effet, on ne peut pas parler de feu (combustion) en absence d’oxygène
(dioxygène).
Ainsi, un facteur déclencheur (une source de chaleur) comme
un mégot ou une étincelle peut rapidement entrainer une combustion.
Causes des incendies de forêts:
L’origine d’un
incendie de forêt est souvent difficile à déterminer du fait de l’absence de
preuves matérielles concrètes ; il en résulte que le pourcentage de causes
inconnues peut être très important. Ce pourcentage, en nombre d’incendies,
atteint 18 % en Espagne, 33 % en France, 26 % en Grèce, 31 % au Portugal et 48
% en Turquie[1].
Cependant, il existe différents niveaux de certitudes ; en France
par exemple, la connaissance de la cause est renseignée à l’aide d’un des
niveaux suivants : certaine, très probable, supposée, inconnue.
Toutefois Les incendies de forêt peuvent être d'origine naturelle, ou
humaine (intentionnel et criminel, involontaire et accidentel).
Causes naturelles
Un incendie peut se déclenché d’une manière naturelle sans intervention
de l’Homme a cause d’une éruption volcanique[2] ou foudre,cette dernière très répandue en forêt boréale (orages secs), est
relativement rare en région méditerranéenne, en effet c’est l’unique cause
naturelle connue dans le Bassin Méditerranéen, elles représentent 1 à 5% des
départs de feu seulement[3].
Causes humaines
Involontaires et accidentels
Elles représentent l’essentiel des origines des incendies de forêts d’une
manière générale, pour l’ensemble des pays du Bassin Méditerranéen.
Elles résultent de négligence par rapport aux risques d’incendie, elles
sont à l’origine de 5 feux sur 10.
Les travaux agricoles (déboisement
à fin de mise en culture, feux d’écobuage) et forestiers, les jeux d’enfants et
les travaux domestiques sont, avec les mégots et les barbecues, les premières causes
d’éclosions. Les accidents (transformateurs électriques, voiture en feu...) se
rencontrent aussi.
Pour les pays où l’économie est basée sur l’agriculture, les travaux
agricoles l’une des causes les plus importantes (Ex : jusqu’à 65 % en Syrie[1]).
Intentionnelles et criminels
La malveillance représente 39%
des incendies, elle peut être due à la pyromanie, conflit de territoire,
vengeance, etc.
A titre d’exemple, en France, et selon les
statistiques publiées par la SCEES, les causes connues de départ de feu entre
1992 et 1998 (hors zone méditerranéenne) sont organisés de la manière
suivante :
 |
| Figure: Causes connues de départ de feu entre 1992 et 1998 en France |
|
 |
| Figure: Causes des incendies de forêt au niveau du bassins méditerranéen, FAO, Rome 2001[1]. |
Les différents
types de feux de foret
Une fois déclenché, un feu de forêt peut
prendre différentes formes, chacune étant conditionnée par le type des
formations végétales et les conditions climatiques (Force et direction du vent,
température ambiante). Ainsi on distingue 3 types de feux de forêts, qui, peuvent
se produire séparément ou simultanément sur une même zone :
• les feux de sol : (appelés aussi feux de voune, feux d’avoune, feux
souterrains ou feux de profondeur). Ils se déclenchent dans des grandes
accumulations d’humus, de tourbe et d’autre débris de végétation morte
semblables assez secs. Alimentés par incandescence avec combustion, leur vitesse
de propagation est faible.
Bien que peu virulents, ils
peuvent être très destructeurs en s’attaquant aux systèmes souterrains des
végétaux. Ils peuvent également couver en profondeur et ils demandent de grandes
quantité d’eau ce qui rend plus difficile leur extinction complète.
Il arrive que, en particulier durant
les longues périodes de sécheresse, de tels feux brûlent tout l’hiver en
profondeur et émergent de nouveau à la surface du sol avec l’arrivée du
printemps.
 |
| Figure animée: Mécanisme des feux de sol |
• les feux de surface : Ils brûlent les
strates basses de la végétation (partie supérieure de la litière, la strate
herbacée et les ligneux bas). Leurs propagation se fait par rayonnement en
général et affectent la garrigue ou les landes.
Leur propagation peut être rapide
lorsqu’ils se développent librement et que les conditions de vent ou de relief
y sont favorables (feux de pente).
 |
| Figure: illustration de feux de surface |
• les feux de cimes : Ils brûlent les
parties supérieures des arbres (ligneux hauts) en formant une couronne de feu
tout en libérant de grandes quantités d’énergie et leur vitesse de propagation est
très élevée. Ils sont d’autant plus intenses et difficiles à contrôler que le
vent est fort et le combustible sec.
 |
| Figure: illustration de feux de cimes |
Les facteurs
favorisant le risque de feux de forêt
L' l’état, la composition et la structure de la végétation,
les conditions météorologiques et le relief, les activités humaines, les
problèmes liés aux logistiques et le manque d’expérience ou l’absence totale
d’une politique de lutte contre les incendies de forêts sont des facteurs qui peuvent plus ou moins
favoriser l’éclosion et la propagation des feux de forêt.
- l’état de la végétation :
L’état
de la végétation (combustible) est très important dans le processus de la
combustion. En effet pendant la combustion du bois, une grande partie de
l'énergie produite est consacrée à chauffer et vaporiser l'eau contenue dans le
bois dont la capacité thermique et la chaleur latente
sont particulièrement élevées. Le bois vert contient plus de la moitié de son
poids en eau.
– 1,7 kWh/kg à 60 %
d'humidité ;
– 4,0 kWh/kg à 20 %
d'humidité ;
– 4,4 kWh/kg à 11 %
d'humidité.
Cependant le taux d’humidité (d’eau) dans le
combustible est un facteur clé dans le déclenchement et la propagation des feux
de forêts et peut donner des fausses réflexions sur le processus de combustion.
Le feu se déclenche dans le combustible dont le taux d’humidité est faible (litières,
herbacées sèches, etc.), puis se propage dans tout type de combustible, de
plus, le combustible dont le taux d’humidité est élevé intervient dans la
propagation du feu en dégageant non seulement la vapeur d’eau chaude mais aussi le comburant hautement inflammable.
- La composition
de la végétation :
Certaines formations végétales sont prédisposées au
feu que d’autres ; leur vulnérabilité ou leur résistance dépend de
nombreux facteurs, essentiellement de leur composition spécifique, surtout
lorsqu’il s’agit de la présence des espèces dites « pyrophytes ».
Les pyrophytes sont
des espèces végétales qui tolèrent le feu, certaines sont qualifiées de
pyrophytes actifs, comme l’Eucalyptus, qui
favorise les départs de feu en produisant des vapeurs inflammables ce qui
empêche d’autres espèces d'envahir leur habitat. D’autres espèces comme Erica arborea, Sequoiadendron
giganteum, Sequoia sempervirens, Quercus suber L. et Melaleuca
quinquenervia sont des pyrophytes
passifs qui résistent au feu grâce à
leurs écorces épaisses.
Des espèces comme Pinus
halepensis, Pinus nigra,
Pinus contorta, les
feux modérés, favorise l'éclatement des pignes, la dispersion des graines et le
nettoyage des sous-bois.
D’autres espèces comme les Cistes ont besoin de feu pour lever la dormance des graines, ce sont des
plantes pyrophiles.
- Structure de la végétation :
La structure du
peuplement forestier - qui évolue dans l’espace temps - joue un rôle essentiel dans la résistance ou
la propagation des feux de forêts. Ainsi c’est la continuité/discontinuité du
couvert végétal, horizontale (recouvrement) et verticale (strates), qui va
majoritairement influencer la
sensibilité au feu du peuplement forestier / subforestiser, en favorisant ou
non la propagation de l’incendie.
L’intensité du
feu dépend également de la microstructure. Plus un combustible est
finement divisé, meilleur est le contact avec le comburant, et donc plus la combustion
est facilitée. Ainsi :
- Des aiguilles
tombées au sol récemment forment un tapis aéré, facilitant le contact entre
l’air et la matière végétale et donc la combustion.
- En
revanche, un tapis d’aiguilles au sol depuis longtemps, tassées sous l’effet du
vieillissement et des intempéries, forme une couche beaucoup plus compacte, rendant
la combustion plus difficile.
- Les conditions météorologiques et d’orographie :
Les
conditions météorologiques telles que la température, le taux d’humidité de
l’air, le stresse hydrique et le vent influencent fortement la sensibilité de
la végétation au feu.
-Un déficit hydrique avec sécheresse et température
élevée conduisent au desséchement du matériel végétal favorable à l’éclosion.
De plus les températures élevées accélèrent le processus d’évapotranspiration,
qui se manifeste chez les pyrophytes par le dégagement des essences hautement
inflammables.
- le taux d’humidité est un facteur qui augment le
risque d’incendie, que se soit pour l’éclosion ou pour la propagation du feu.
En effet la vapeur d’eau augmente considérablement la température de l’air et
forme des courants de convection thermique.
-Le vent quand à lui, est un vecteur mobile qui
influence la cinétique des incendies, en effet, il alimente le feu par
l’oxygène, mais détermine aussi sa vitesse
et sa direction de propagation. De plus, le vent accélère les réactions de
combustions lorsqu’il est chargé de masses chaudes.
Encore même après l’extinction d’un incendie, le
vent peut toujours faire repartir un feu, mais peut aussi projeter des bouts de
végétaux enflammés plus loin sur les cimes des arbres. C’est ce qu’on appelle
des « sautes de feu ». Ce scénario est rare, mais le danger est
sévère.
 |
| Figure: mécanisme du saute de feu |
|
|
Les caractéristiques d’orographie telles que la
topographie (pente, cuvette…), reliefs et l’exposition
influencent aussi sur la propagation des incendies ;Les zones exposées (versants au vent) et les zones
en haute altitude vont être plus soumises à l’action des vents.
Dans les zones accidentées, les feux qui
naissent à la base d’une pente, vont la gravir à toute vitesse du fait que le
haut de la flamme brûle plus intensément. Dans une pente, le feu va donc
toujours brûler vers le haut (ce sont les feux de pente).
En
outre, en montagne, les conditions d’accès sont plus difficiles; les chemins tortueux handicapent les
opérations d’extinctions et de e secours.
Références:
Felix Kogan, FAO 1998. Etude FAO Forêts 138 - Réunion de
la FAO sur les Politiques Nationales Ayant une Incidence sur les Incendies de
Forêt, Rome, 28-30 octobre 1998.
(http://www.fao.org/docrep/003/x2095f/x2095f0m.htm)
[1] FAO,Rome 2001 ; Pierre-Yves Colin et al. ,"Protection des forets contre l'incendie, Fiches techniques pour les pays du bassin méditerranéen" / ISBN 92-5-204678-X
[2], Les éruptions volcaniques
peuvent également être à l’origine d’incendies de forêt. Ce phénomène est
cependant exceptionnel dans le Bassin Méditerranéen.
[3] Des
exceptions peuvent toutefois être observées, notamment en Espagne, où, dans
certaines régions, la foudre représente 30 % des départs de feu (Aragon : 38 %
et Castille la Manche : 29 %).


























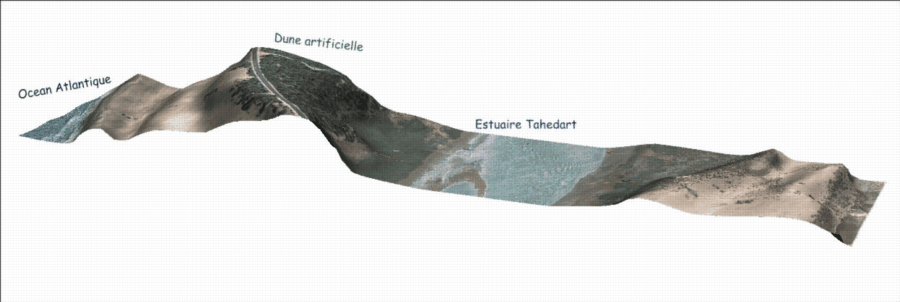




0 commentaires:
Enregistrer un commentaire
Abonnement Publier les commentaires [Atom]
<< Accueil