Biodiversité de l'aire protégée Jbel Hbib (Nord du MAROC)
 |
| (Aire protégée Jbel Hbib) Aperçu en 3D |
Introduction:
Au Maroc,
la biodiversité est représentée par plus de 24 000 espèces animales et 7000
taxons végétales avec un taux d’endémisme global de 11% pour la faune et de
plus de 20% pour les plantes vasculaires, taux presque sans égal dans tout le
bassin méditerranéen . La diversité des écosystèmes est tout
aussi remarquable. En effet, en plus des écosystèmes côtiers et marins,
méditerranéens ou atlantiques, une quarantaine de milieux continentaux ont été
identifiés comme particulièrement riches en biodiversité, dont près des trois
quart sont représentés par des écosystèmes forestiers stricts (forêt) et des
écosystèmes pré-forestiers et pré-steppiques. Des sources
antérieures (Ibn Tattou et Fennane, 1989) font état de 4200 espèces et sous
espèces végétales vasculaires existant au Maroc répartis sur 940 genres et 135
familles dont 20% endémiques, et de 550 espèces de vertébrés environ dont 6,3%
endémiques.
Cette
biodiversité, du fait de ces diverses utilisations, des divers services vitaux
fournis par les écosystèmes, revêt pour l’homme une importance capitale. Ses
principales valeurs décelables sur le plan économique, culturel et social,
écologique et symbolique, aident à mieux apprécier son importance.
Cependant,
cette remarquable biodiversité du Maroc ne cesse de s’estomper au cours de ces
dernières décennies. On estime que 1/3 des écosystèmes sont très dégradés,
fragilisés et en voie de disparaître sur le court terme, 31.000 ha de forêt et 22.000 ha de parcours
subissent les différents processus de dégradation chaque année (Samuel, 1996).
A ceux-ci, s’ajoute une longue liste d’espèces faunistiques disparues, rares,
ou menacées.
Les
principaux facteurs identifiés comme causes de cette régression de la
biodiversité sont nombreux mais le facteur anthropique reste sans nul doute la
cause majeure. Au Maroc, cette dernière se présente sous diverses formes, à
savoir l’exploitation abusive faite sur les ressources naturelles,
l’urbanisation et l’occupation du littoral, le défrichement et la mise en
culture des forêts et autres écosystèmes naturels. Ceux-ci, provoquent la
dégradation, la fragmentation des écosystèmes naturels, et par conséquent des
habitats qui sont principalement à l’origine de l’important appauvrissement de
la biodiversité (Benabid, 2000).
Les
principaux objectifs de la mise en place de ces différentes aires protégées, est
la préservation des écosystèmes représentatifs du patrimoine historique naturel
et culturel garant du développement durable du Maroc.
L’aire
protégée de Jbel Lahbib, est une aire protégée du domaine continental. Il
figure parmi les sept sites du Maroc inclus dans la réserve de biosphère
intercontinentale de la méditerranée (R.B.I.M) Maroc-Andalousie. Cette aire
protégée renferme des écosystèmes particuliers assez conservés abritant des groupements
végétaux aussi bien riches que diversifiés et une faune riche (Benabid, 1982;
Anonyme, 1997). Mais les valeurs de biodiversité de cette aire protégée ne sont
pas encore suffisamment connues.
La
connaissance de l’état de la biodiversité, de ses valeurs et des évolutions
spatio-temporelles à entreprendre dans le cadre d’un ensemble des cartes
thématiques approprié permettra d’assurer la conservation et la valorisation des
potentialités du site.
L’objectif
global de ce travail de recherche est d’élaborer des cartes thématiques de
l’aire protégée qui permettrait la bonne connaissance et la valorisation de
cette région, tout en essayant de montrer et présenter tous les atouts de la
région et sans oublier de mettre l’éclairage sur les points faibles et les
menaces qui dévalorisent cette aire protégée.
Les
objectifs spécifiques assignés à ce travail sont les suivants:
Avoir un document de base sur l’aire
protégée « Jbel LAHBIB »
Réaliser un document bien détaillé qui
inclue une étude globale sur l’aire protégée.
Réaliser des cartes thématiques sur la
région afin de révéler les variations spatio-temporelles de cette aire
protégée.
Dévoiler la richesse naturelle et
culturelle peu connue de la région.
Mettre en valeur l’aire protégée et la
population locale.
Contribuer à la conservation et à la
valorisation de la biodiversité de la région.
La promotion d’un modèle de développement
durable.
Les aires protégées au Maroc:
A l’instar
de tous les pays de la planète, le Maroc s’est inscrit dans la politique de
protection des richesses biologiques à travers la création et la mise en place
d’un réseau national d’aires protégées permettant de garantir la sauvegarde et
la pérennisation de ces espaces d’intérêt mondial.
Le réseau
national des aires protégées, situé en grande partie dans les milieux
forestiers, composé par les 154 Sites d’Intérêt Biologique et Écologique,
représentatifs des 39 écosystèmes naturels du pays et couvrant une superficie
totale de près de 4 millions d’hectares est la plate forme de la réussite de
cette démarche (Naïm NACHID. 2010). Cette dernière repose sur les quatre
principes fondamentaux suivants, qui tirent d’ailleurs leurs origines à partir
du Programme Forestier National :
• Approche
Patrimoniale ; • Approche Territoriale ;
• Approche Partenariale ; • Approche
Participative.
A cet
effet, sur les 154 sites d’aires protégées précités, dont l’importance sur les
plans de la recherche, de la conservation de la faune et la flore, du
développement socioéconomique, de l’éducation environnementale et la récréation
n’est pas à démontrer, une trentaine font partie actuellement de projets de
conservation, de réhabilitation et de développement durable couvrant ainsi 50%
de la superficie de la totalité du réseau national (Naïm NACHID. 2010).
Pendant
cette dernière décade, la notion d’aires protégées et de gestion durable de la
biodiversité commence à prendre de la place au sein des décideurs et de la
société civile.
Conscient
de ces faits, et suite à la conférence de Rio sur le développement durable, le
Maroc, comme les autres pays de la communauté internationale a été appelé à
mettre en place une stratégie nationale sur les aires protégées afin de pouvoir
sauvegarder son patrimoine biologique dans un cadre institutionnel et planifié.
L’Étude
Nationale sur les Aires Protégées finalisée en 1995 a permis de faire un
constat sur les potentialités naturelles du pays, le statut des diverses
espèces de faune et de flore, et de proposer la mise en place d’un réseau
national d’aires protégées couvrant les principaux échantillons de la
biodiversité marocaine.
Cette étude
a permis de tirer les conclusions suivantes :
*Le Maroc occupe
la 2ème place en matière de biodiversité à l’échelon de la méditerranée après la Turquie, avec un taux
d’endémisme de plus de 20% ;
*1/3 de ses
écosystèmes naturels sont dégradé ; 1/4 de sa flore est en danger ;
*10% des
vertébrés sont en voie de disparition (Naïm NACHID. 2010).
Les Aires
Protégées sont devenues des espaces naturels intégrées dans pratiquement tous
les schémas d’aménagement du territoire ainsi que les projets de développement
rural intégré. De même, l’administration gestionnaire des aires protégées est
devenue un acteur principal dans l’élaboration des études d’aménagement du
territoire et les études d’impact environnementaux touchant les espaces
naturels en général et les éléments de la diversité biologique en particulier.
Aussi, la
valorisation de ces aires protégées doit être la clé du développement durable
puisque la question économique se trouve toujours dans le centre des débats.
Des propositions audacieuses doivent être formulées, testées et évaluées puis
généralisées pour faire sentir les retombées économiques des espaces naturels
sur les populations usagères. Le développement de l’écotourisme avec ses
différentes formules, de l’industrie des plantes aromatiques et médicinales, de
la commercialisation des produits biologiques et labellisées sont autant de
propositions concrètes et applicables pour générer des revenues alternatives
aux usagers des espaces naturels.
I.2. La Réserve de la Biosphère
Intercontinentale de la Méditerranée (RBIM)
La Réserve de la Biosphère Intercontinentale
de la Méditerranée
(RBIM) s’étend sur l’Andalousie, en Espagne et le nord du Maroc sur une
superficie supérieure à un million d’hectares (Figure 1, 2). Classée par
l’UNESCO en octobre 2006, il s’agit de l’unique aire protégée occupée par une
mer et couvrant deux continents. Son objectif général est la promotion d'un
modèle de développement durable. La dimension sociale de celui-ci est
significative, étant donnée la nécessité de la participation active des
populations locales, qui détiennent les savoirs traditionnels mais qui ont en
même temps besoin d'être éduquées au sujet des innovations techniques
nécessaires à la réorientation de leurs pratiques économiques, sur la base d'un
modèle de développement rationnel qui puisse garantir un avenir digne et
solidaire.
Objectifs
de la RBIM :
Tel
qu’établit par la stratégie du programme MaB-UNESCO (Séville 1995), les
réserves de biosphère visent:
-
La conservation de la diversité naturelle
et culturelle.
-
Le développement d’un modèle de gestion
territoriale et la mise en œuvre d’un développement durable.
-
La promotion de la recherche, du suivi, de
l’éducation et de la formation.
-
La promotion de la participation des
sociétés locales.
-
Le développement de la coopération et de la
collaboration logistique.
Parmi les objectifs
spécifiques de la RBIM
au niveau transfrontalier :
-
Promouvoir le développement et la
consolidation du réseau d’espaces naturels protégés du sud de l’Andalousie et
du nord du Maroc.
-
Promouvoir un modèle de développement
durable favorisant la mise en valeur et la conservation des ressources
naturelles et culturelles spécifiques et partagées du territoire de la RBIM, ainsi que la
participation et le développement social et économique des populations locales
concernées.
-
Promouvoir la coopération entre les deux
pays et le développement d’outils communs de gestion et de coordination pour la
conservation des ressources naturelles et le développement de l’homme (Plan
d’Action de la RBIM,
2006).
La RBIM constitue une
entité homogène et représentative des écosystèmes et de la culture de la Méditerranée
occidentale. Elle offre une énorme diversité d’habitats, d’espèces résidentes
et d’endémismes. De plus, au niveau international, c’est un espace de premier
ordre pour les espèces migratoires terrestres et marines. Son territoire
transfrontalier partage de nombreux éléments en matière de patrimoine
historique, artistique et culturel ainsi que de nombreuses traditions en
matière de valorisation et de gestion des ressources naturelles.
Présentation de l'aire protégée Jbel Hbib:
La
zone d’étude se situe dans une région hautement qualifiée comme un hot-spot de
la biodiversité, la raison pour laquelle elle est classée parmi la Réserve de la Biosphère
Intercontinentale de la Méditerranée (RBIM).
Ce choix n’est pas dû au hasard, mais, parce que c’est une région qui recèle
une diversité spécifique très remarquable, et malgré tout cela, elle souffre
d’une mauvaise gestion du milieu naturel, chose qui la laisse mal connue et non
développée.
Ainsi, le choix de
cette région s’est basé sur ces points faibles et sur le manque d’études
réalisées sur cette aire protégée surtout dans le domaine de la cartographie, mais
aussi, sur les points à améliorer et les points forts. Dans cette présente
étude, nous allons essayer de le mettre en valeur, renforcer sa protection et
maintenir ce patrimoine naturel remarquable.
Figure 5:
Vue en 3D de l’aire protégée « Jbel Hbib » ,versant Nord-Est
(MNT
ASTER GDEM texturé par une image GeoEye1 du 09//2009)
Situation
géographique
L’aire
protégée de Jbel Lahbib fait partie du massif forestier de Jbel Lahbib, situé
sur une des montagnes de la chaine rifaine qui culmine à 915 m, se situe entre la latitude 35°24’33,19’’ N et
35°31’48,30’’ N et la longitude 5°41’19,99’’W et 5°49’10,87’’W. S’étendant sur
une superficie de 3409 ha,
cette aire protégée couvre les parties hautes des versants nord et sud de cette
chaîne de montagne. Il se trouve à 5
km à l’est de la Commune rurale de Jbel Lahbib et à 2,645 km au sud du barrage
9 avril . Il est limité au sud par l’oued Fatêt, à l’est par une
piste qui relie les douars Bni Hâtem et Harcha (PDAP. 1996).

Image satellite
Landsat 7 TM 4-5 (09/05/2011) en composition colorée (5,4,3) "En rouge l’aire
d’étude"
Situation
administrative
L’aire protégée de
Jbel Lahbib se trouve entièrement dans la province de Tétouan, il relève des
cercles de Tétouan et de Jbala, de caïdat de Ben Karrich et Jbel Lahbib. Il
occupe les parties sud de la commune rurale de Bni Harchen, à l’ouest de la
commune rurale Jbel Lahbib et au nord de la commune rurale d’Al Karroub. Le
site se situe en grande partie dans les communes rurales de Jbel Lahbib (1793,87 ha), et Bni
Harchen (1170,97 ha)
; seuls 444,16 ha
se trouvent dans la commune rurale d’Al Kharroub.
Situation
forestière
La zone d’étude est
ancrée en totalité dans le massif forestier de Jbel Lahbib. Sa gestion relève
du point de vu forestier (IFN. 1990-2005) à la Direction Régionale
des Eaux et Forêts et de la
Lutte Contre la Désertification du Rif (DREFLCD-Rif) (Figure 8),
de la Direction
Provinciale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification de
Tétouan (DPEFLCD-Tétouan), du Centre de Conservation et de Développement des
Ressources Forestières de Ben Karrich. Le secteur d’El Harcha est le seul
secteur responsable de la gestion de l’aire protégée (SDAFR. 2004).
Géologie
et Géomorphologie
Les
principales unités géologiques qui existent dans notre zone d’étude sont (El
Gharbaoui. 1981) :
L’unité
de Tanger du domaine externe, le domaine des flyschs est constitué des flyschs
numidiens, en plus des formations post-nappes,
L’unité
de Tanger du domaine externe affleure surtout entre les nappes numidiennes de
Talat Lakrah. Elle est essentiellement constituée de marnes du Crétacé, les
faciès caractéristiques étant: Faciès marneux, marno-calcaire à boules jaunes
et argileux; Argiles calcaireuses gris violacé ; Faciès argileux dominant;
Argilites pélitiques grises.
La
zone est caractérisée sur le plan Géomorphologique par (El Gharbaoui. 1981):
-
Une crête gréseuse du Numidien et des flyschs marno-gréseux de Talaa Lakraa
-
Les formations tendres de l'unité de Tanger;
-
Les coulées boueuses témoignant d'un phénomène de solifluxion.
Des
barres de grès et quartzite résultant de l'érosion différentielle dans les
flyschs sont un trait remarquable dans l’aire protégée de Jbel Lahbib, les
bancs durs restent en saillie après érosion des matériaux tendres sous-jacents.
L’aire
protégée de Jbel Lahbib se caractérise par des crêtes plates qui offrent une
vue panoramique du site et des paysages aux alentours.
Pour
les expositions : - 816
ha de l’aire protégée de Jbel Lahbib se situent sur une
zone favorable à la pluviométrie (expositions nord, nord-ouest, ouest) ;
-1639 ha se trouvent dans une zone défavorable
à la pluviométrie (expositions est, sud-est, sud).
Précipitations
L'étude climatique de
l’aire protégée de Jbel Lahbib s'est réalisée à partir des données mensuelles
et annuelles des principales stations météorologiques de la zone d’étude. Ces
données couvrent une période assez importante (1980-2006) bien qu’elles restent
en partie lacunaires sur certaines stations (ABHL. 2009).
La
figure 9 montre que la période la plus pluvieuse se situe entre le mois
d’octobre et d’avril avec des variations allant de 50,3mm à 100mm. Elle dévoile
une différence assez nette entre les différentes stations de l’aire protégée,
la station de Skarrich a enregistré des valeurs de précipitation annuelle très
élevées par rapport aux autres.





















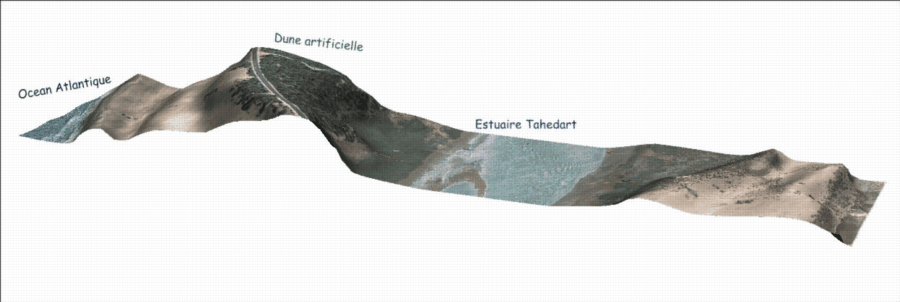



0 commentaires:
Enregistrer un commentaire
Abonnement Publier les commentaires [Atom]
<< Accueil